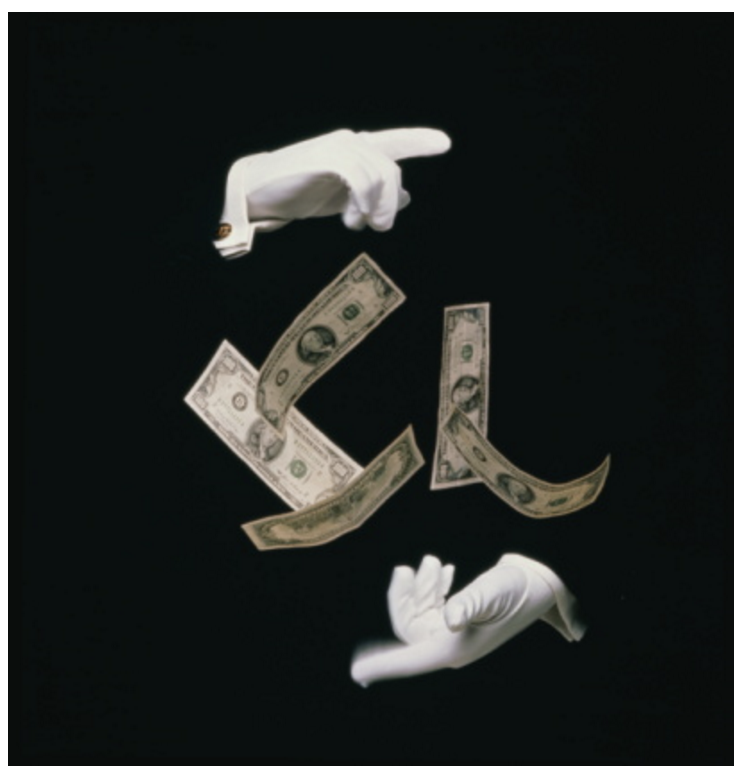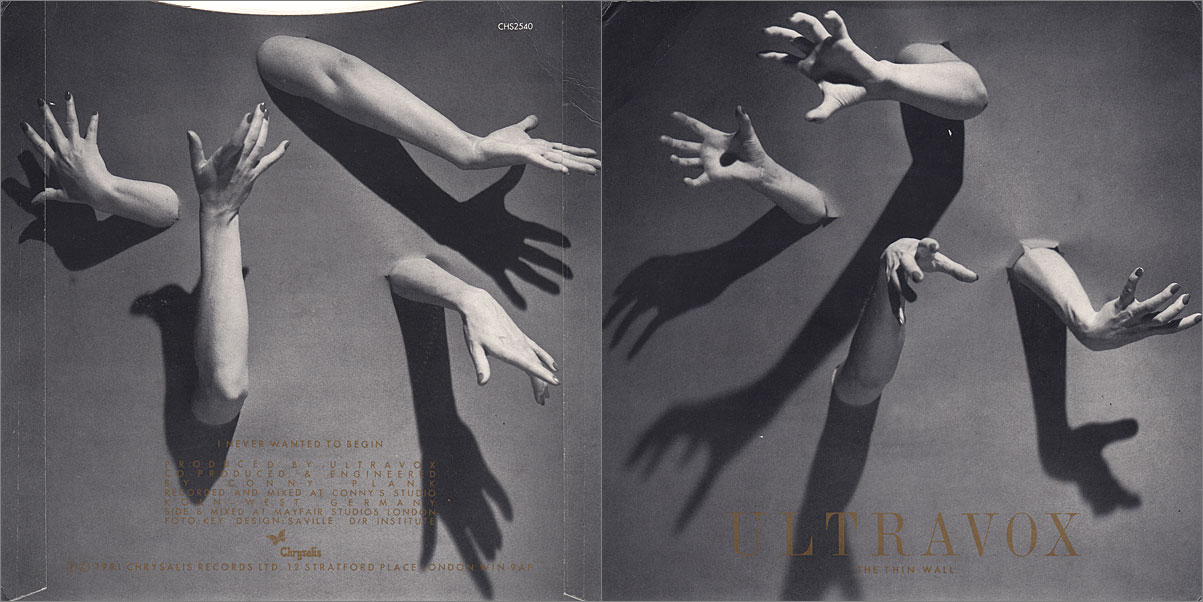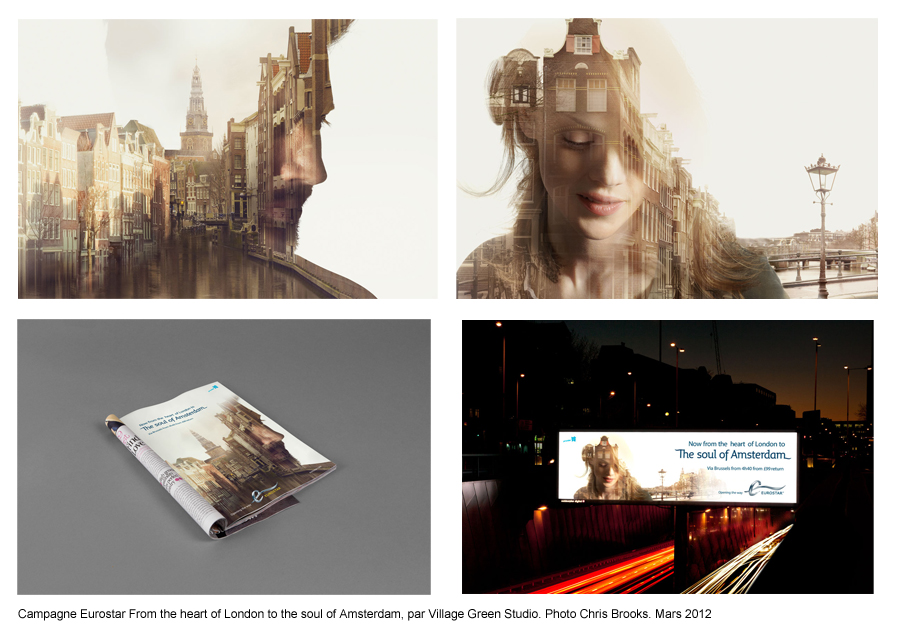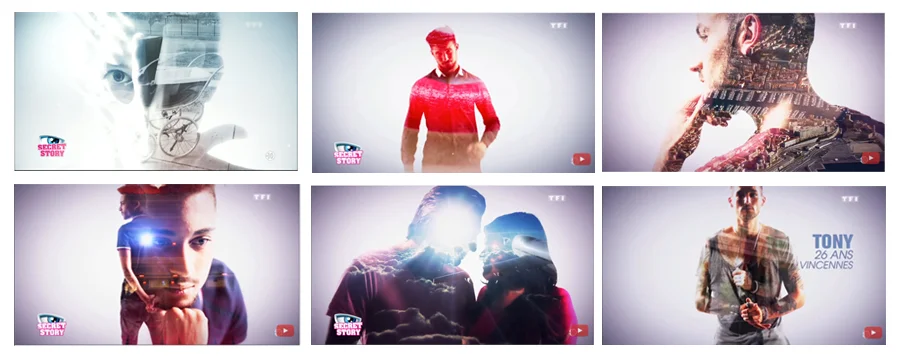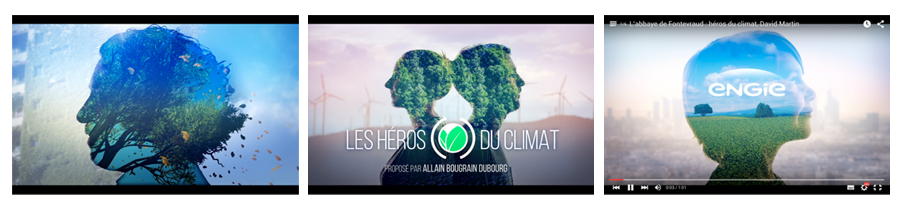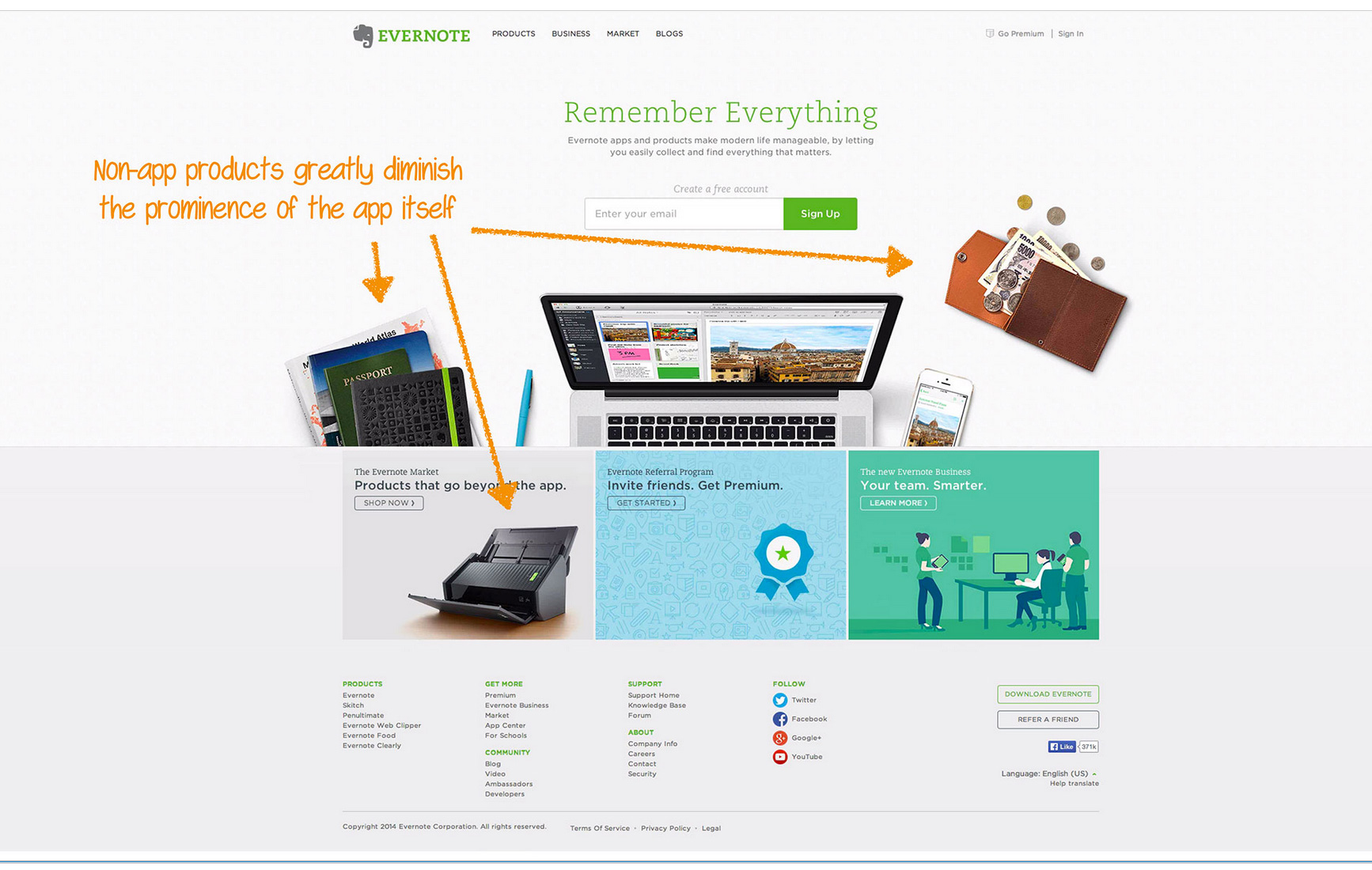Des mains qui sortent du mur ? Un visual trend que l’on voit ressurgir qui ces derniers temps. Chez Paul et Martin, avec une esthétique pop, kitsch, et des couleurs acides, chez ToiletPaper, de manière plus dérangeante et subversive…
Image poétique. Héritage surréaliste. Référence à la magie. Des mains sans corps, autonomes, on en voit beaucoup dans l'histoire du cinéma : the Thing, dans la famille Addams, The Crawling Hand…
Petit déroulé en images depuis La Belle et la Bête, de Cocteau.
© Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari
Magicien © Getty
© Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari
© Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari
© Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari
© Mehdi Saeedi
Bol, Harry Allen
Patère, Harry Allen
Campagne Mumm, agence Marcel, photo Martin Vallin, 2012
Ultravox, The Thin Wall, 1981, design Peter Saville
Charlie et la chocolaterie, Mel Stuart, 1972
Répulsion, Roman Polanski, 1965
The Thing, Addams Family (1964)
La Belle et la Bête, Jean Cocteau, 1946
La Belle et la Bête, Jean Cocteau, 1946